/image%2F1490480%2F20211209%2Fob_ee72b7_teckel-triste.jpg)
“Les bêtes n'ont pas seulement moins de raison que les hommes, elles n'en ont point du tout” nous dit Descartes et, dans sa lettre au Marquis de Newcastle, il explique que le comportement animal est uniquement instinctif, c’est-à-dire régi par un ensemble de mécanismes qui s’active automatiquement en réaction aux signaux produits par son environnement. Pour lui, l’animal n’est qu’une machine perfectionnée.
Toutefois, le temps de « l’animal-machine » cher à Descartes est depuis longtemps dépassé. On sait aujourd’hui que les animaux ne sont pas de simples mécaniques : ils sont capables d’adopter des comportements propres qui ne sont pas qu’instinctifs.
En 1872, dans son livre « l’expression des émotions chez l’homme et les animaux », Charles Darwin rapportait nombre de situations où les animaux qu’il étudiait étaient doués d’émotions parfois complexes. Il rapportait ainsi ses observations de la jalousie d’un orang-outan ou de la colère d’un lézard, ailleurs de la joie du chien remuant sa queue, le grognement de satisfaction d’un porc, voire la déception suivie d’une grosse colère d’un chimpanzé. Pour le scientifique, ce n’était pas une énorme surprise puisqu’il était convaincu avec raison que, l’origine biologique des êtres vivants étant commune, l’Évolution avait permis de conserver chez eux des comportements comparables. Pour Darwin, entre homme et animal, il n’y a pas de différence de nature mais uniquement de degrés.
Une centaine d’années plus tard, Konrad Lorenz recevait le prix Nobel pour ses travaux sur le comportement des animaux et, pour lui aussi, les émotions animales sont indiscutables.
Un contresens historique : la vision mécaniciste des animaux
Cela peut paraître aujourd’hui étonnant mais les conceptions de Darwin et de Lorenz sont restées minoritaires durant des siècles parmi les scientifiques. Pour les savants de l’époque, les animaux n’étaient que des êtres primitifs conditionnés pour ne répondre à des stimuli que de façon instinctive. Sans intelligence ni émotions, ce n’était en somme que des « bêtes ». Et c’était plutôt commode pour en faire des objets d’expérimentation. Cette vision réductrice (et singulièrement erronée) a longtemps persisté puisque, en 1987 encore, dans une revue célèbre (l’Oxford Compagnion to Animal Behaviour), on pouvait toujours lire « l’étude des émotions animales n’a aucun intérêt puisqu’elle ne nous apprend rien ». La raison de cet aveuglement ? La peur de faire de l’anthropomorphisme… Or, si celui-ci existe parfois, notamment chez le profane, ce n’est certainement pas le cas ici.
/image%2F1490480%2F20211209%2Fob_eef813_chat-tue-rat.jpg)
Il est vrai qu’il peut sembler compliqué de mettre en évidence une émotion animale et de la dissocier d’un simple comportement instinctif. Prenons, par exemple, le cas d’un ratqui se trouve acculé par un chat dans le fond d’une impasse. Il s’immobilise, cherche à fuir, crie désespérément tandis que sa fréquence cardiaque augmente considérablement et qu’il sécrète des flots d’adrénaline : il présente donc toutes les apparences de la peur. Mais a-t-il vraiment conscience de sa peur et des modifications soudaines de son corps ? Certains diront que le rat ne ressent pas la peur au vrai sens du terme, qu’il ne présente que des réactions automatiques de défense… Et pourtant…
La notion « d’émotion animale » est encore plus discutée si l’on cherche à savoir si les animaux peuvent avoir le souvenir d’événements passés susceptibles d’influencer leur comportement. Par exemple, dans le cas de notre rat acculé par un chat, si le rongeur a eu la chance d’échapper à son prédateur, aura-t-il une « peur par anticipation » en revenant près de l’impasse où il fut attaqué ? Présentera-t-il une émotion alors qu’aucun danger ne le guette plus ? On parle ici « d’émotion secondaire » puisque le sujet anticipe une situation qui ne s’est pas encore reproduite, qui n’existe finalement pas.
Les scientifiques ont cherché à évaluer ce domaine de l’émotion secondaire animale et, pour se faire, une expérience célèbre est la suivante : on offre un bonbon à un enfant et on lui dit qu’il en aura un second s’il attend, disons cinq minutes, avant de le manger. L’enfant cherche alors à patienter en chantonnant ou en gigotant, voire
/image%2F1490480%2F20211209%2Fob_b1158c_singe-recompense.jpg)
en un jeu lui permettant de se distraire afin de ne pas céder à la tentation. Eh bien, les singes usent exactement des mêmes stratagèmes pour obtenir la seconde récompense. Des expériences identiques ont également été réalisées avec d’autres animaux. Si ceux-ci essaient de se divertir pour ne pas être tentés, n’est-ce pas parce qu’ils ont conscience de leurs émotions ?
De fait, comme nous le verrons par la suite, la compréhension humaine des émotions animales a considérablement évolué depuis quelques années et il n’est plus guère de scientifiques qui croient encore à l’animal-machine de Descartes.
De nombreux domaines sont concernés par l’émotivité animale
Pour conforter ce qui vient d’être écrit, prenons quelques exemples de comportements animaux qu’il semble difficile de dissocier d’authentiques émotions.
* le chien est sensible aux reproches de son maître
Lorsqu’il a « fait une bêtise » et qu’il est réprimandé, le chien adopte souvent une attitude très particulière : queue entre les pattes, oreilles abaissées, regard piteux. Pour certains scientifiques, c’est l’attitude de leur maître qui conditionne leur comportement : qu’ils aient fauté ou non, si le maître semble vouloir le punir, ils affecteraient dans tous les cas une attitude coupable. Toutefois, pourquoi un chien prendrait-il alors un air coupable avant que son maître n’ait eu connaissance de sa faute (comme tous les propriétaires de chiens ont pu le remarquer) ? Remords ou anticipation des conséquences de son acte ?
* les animaux savent faire preuve d’attachement
Quatre-vingt dix pour cent des oiseaux arrivent à former de véritables couples : oisillons élevés à deux après des relations sexuelles exclusives, joie de se retrouver ou, au contraire, tristesse lors d’une séparation. Cette propension à la vie à deux se retrouve dans bien d’autres espèces, jusqu’à 25% chez les primates. Les éthologues préfèrent utiliser le terme d’attachement mais n’est-ce pas en définitive une forme d’amour ?
Dans le même ordre d’idée, nous avons tous en mémoire des exemples d’amitié intangible entre individus d’une même espèce, voire d’espèces différentes comme cela est souvent rapporté par exemple entre des chiens et des chats.
Sentiments authentiques ou simples réactions hormonales ?
* les girafes respectent leurs adversaires
/image%2F1490480%2F20211209%2Fob_129205_girafes-combat.jpg)
Dans une étude récente, des éthologues britanniques ont pu mettre en évidence que, chez ces animaux habituellement tranquilles, lors de combats entre mâles, lesproportions sont toujours respectées : jamais une girafe n’attaque une plus petite qu’elle et si les combats se passent à grands coups de tête, les côtés « préférés » de l’une ou l’autre sont respectés par l’adversaire tandis que, souvent, un vieux mâle sert d’arbitre, n’hésitant pas à intervenir en cas de nécessité. Des combats à la loyale en somme. Où se situe l’instinct en pareil cas ?
* certains animaux ont du mal à se séparer de leurs enfants morts
En 2018, près des côtes canadiennes, un orque femelle a transporté en surface la dépouille de son petit sur 1600 km durant 17 jours. Ce n’est pas un acte isolé chez ce type d’animaux. Des attitudes similaires ont été notées chez les primates comme nous l’avons déjà signalé dans des articles précédents. Certains scientifiques avancent que les mères en question n’ont peut-être pas conscience de la mort de leur enfant et qu’elles espèrent toujours qu’il va se réveiller. Ce n’est, aujourd’hui, plus l’avis de la plupart des éthologues qui s’accordent pour penser qu’il s’agit ici de véritables périodes de deuil, les mères ne portant pas du tout leurs bébés morts comme elles le feraient avec des vivants.
* bien d’autres exemples existent d’émotions animales
Le dégoût : la femelle chimpanzé Washoe (à qui on avait appris le langage des signes) avait été éduquée à repérer un meuble ou un vêtement tachés. Un jour, agacée par un macaque désagréable, elle s’est mise à signer : « sale singe » ! Comme si elle était dégoûtée par le comportement de son congénère. Était-elle passée du simple descriptif à une signification d’ordre moral ?
Le sens de la justice : de nombreuses expériences ont été réalisées avec des grands singes, des tamarins, des macaques, des corvidés, des chiens qui, toutes, ont montré combien ces animaux sont sensibles à l’inégalité de traitement. Si l’on demande à ces animaux de réaliser un exercice en échange de nourriture, c’est le mécontentement total quand l’un des participants reçoit une plus grande quantité ou une meilleure nourriture. Les participants « spoliés » refusent alors souvent de participer à nouveau à l’exercice. Est-ce de la simple frustration ? De la jalousie ? Pas sûr si l’on songe que certains grands singes vont jusqu’a refuser la récompense qui les avantage…
/image%2F1490480%2F20211211%2Fob_4e5e14_rats-empathie.jpg)
Ils sont capables d’empathie : de nombreuses expériences ont été menées sur cethème avec les rats. L’une d’entre elles consistait à délivrer une quantité identique de nourriture à des rats placés dans un box au moyen de deux leviers. Au bout de quelques jours, forcément, les rats avaient une préférence pour l’un ou l’autre des leviers. L’expérimentateur choisissait alors le levier préféré d’un individu et l’associait, en même temps que la délivrance de la nourriture, à une décharge électrique sur un autre rat. Eh bien, le rat choisissait alors l’autre levier pour ne pas voir souffrir son congénère…
D’autres comportements ont été souvent rapportés...
… comme de ne pas aimer partager leur maître (chiens) ou leurs amis (singes). Ou bien de remercier un être humain au détriment de leur confort immédiat (singes).
On peut constater, au vu de ces quelques exemples (il y en a bien d’autres) qu’il paraît difficile de croire que les animaux n’interagissent avec leur environnement que de manière instinctive : ils présentent d’authentiques émotions ce qui a conduit l’Homme à revoir – certes encore partiellement – ses rapports avec eux.
Notre perception des animaux évolue… et la Loi aussi
/image%2F1490480%2F20211211%2Fob_d867bd_marche-de-yulin.jpg)
Depuis quelques années, un consensus semble se dessiner chez les scientifiques pour reconnaître aux animaux souffrance et émotions et cela d’autant plus que leur systèmenerveux est développé. Cette approche nouvelle de « nos amies les bêtes » s’est peu à peu diffusée à l’ensemble de notre société. Des pratiques ancestrales sont à présent combattues (par exemple, l’horrible marché de la « viande de chiens vivants » de Yulin, en Chine) et ont de moins en moins de succès. On contrôle de mieux en mieux les abattoirs et les élevages et ce sont parfois des associations « non officielles » qui se chargent d’attirer sur eux l’attention de tous.
De ce fait, la Loi, elle aussi, évolue et cherche à étendre les droits des animaux en leur octroyant un certain statut juridique. On n’autorise plus – du moins dans la plupart des pays occidentaux dont la France – les delphinariums où de pauvres dauphins captifs tournaient en rond à longueur de journée. Dans le même ordre d’idées, la disparition des animaux de cirque (et a fortiori de foire) est programmée. Le transport des animaux est également étudié de près et on tolère de moins en moins les élevages en batterie. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses pétitions circulent pour signaler les comportements cruels de certains individus envers les animaux et elles rassemblent parfois suffisamment de monde pour donner lieu à des enquêtes et d’éventuelles poursuites.
En France, le jeudi 18 novembre 2021, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi de lutte contre la maltraitance animale par 332 voix pour, une voix contre et dix abstentions, On sent que sur ce sujet particulièrement sensible les choses évoluent. Et c’est tant mieux.
Sources :
- Wikipédia France
- encyclopaedia britannica
- science-et-vie.com
Images :
- Teckel triste (sources : dreamstime.com)
- Chat et rat (sources : youtube.com)
- Le singe et sa récompense (sources : parismatch.be)
- Combat de girafes (sources : alternatival.com)
- l'empathie chez le rat (sources : scitechdaily.com)
- l'horreur du marché de Yulin en Chine (sources : hebdovinchine.com)
Mots-clés : Charles Darwin - Konrad Lorenz - animal machine - statut juridique des animaux - loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance animale
Sujets apparentés sur le blog
1. l'inné et l'acquis chez l'animal
2. intelligence animale 1 et 2
Dernier sommaire général du blog : cliquer ICI
l'actualité du blog se trouve sur FACEBOOK
mise à jour : 27 mars 2023



/image%2F1490480%2F20210213%2Fob_864c0a_coucou-gris-d-europe.jpg)
/image%2F1490480%2F20210213%2Fob_4ce7a7_coucou-mere-abusee.jpg)
/image%2F1490480%2F20210213%2Fob_dd9a39_coucou-oisillon-se-debarrassant-d-un.jpg)
/image%2F1490480%2F20210213%2Fob_cb79ca_coucou-2.jpg)
/image%2F1490480%2F20210213%2Fob_1275eb_coucou-oeuf-dans-nid.jpg)
/image%2F1490480%2F20210213%2Fob_9f55b7_coucou-oisillon-affame.jpg)












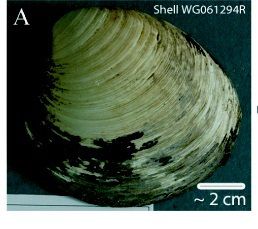

/image%2F1490480%2F20230316%2Fob_088c80_fourmis-de-feu-radeau-2.jpg)
/image%2F1490480%2F20230316%2Fob_6755ef_gnous-migration.jpeg)
/image%2F1490480%2F20230316%2Fob_9fa28f_quelea-quelea.jpeg)
/image%2F1490480%2F20230316%2Fob_de82b6_fourmiliere.jpg)
/image%2F1490480%2F20230316%2Fob_046689_fourmis-combat.jpg)
/image%2F1490480%2F20230316%2Fob_83979e_loups-chassent.jpg)

 rapport à celle qui varie selon les
rapport à celle qui varie selon les 
 un prédateur de disposer d’un organe visuel performant. Le champion toutes catégories est ici un petit animal appelé
un prédateur de disposer d’un organe visuel performant. Le champion toutes catégories est ici un petit animal appelé  les prédateurs. Certains, comme le chat, le loir, plusieurs espèces de renards ont des
les prédateurs. Certains, comme le chat, le loir, plusieurs espèces de renards ont des  populaire. De nombreux animaux ont mis en pratique cet adage. La
populaire. De nombreux animaux ont mis en pratique cet adage. La  jusqu’à 15 cm de profondeur et même de suivre leur trace s’ils ont été bougés. Un autre lézard, le varan géant appelé
jusqu’à 15 cm de profondeur et même de suivre leur trace s’ils ont été bougés. Un autre lézard, le varan géant appelé  Cette capacité concerne certains serpents comme les boas, les pythons et le crotale mais aussi la chauve-souris vampire. La proie est ici repérée par des
Cette capacité concerne certains serpents comme les boas, les pythons et le crotale mais aussi la chauve-souris vampire. La proie est ici repérée par des  les proies se précipitent vers ce phare dans la nuit noire sans voir la bouche du prédateur derrière. Ce poisson est d’ailleurs très spécial et je ne résiste pas à l’envie de vous raconter son mode de reproduction bien particulier. Le mâle est ici beaucoup plus petit que la femelle et il passe son temps à la chercher ; il la repère grâce à son odorat très développé et se colle à elle en la mordant et en libérant de ce fait une enzyme qui dissout sa bouche et la partie mordue de la femelle : les deux animaux fusionnent alors leurs systèmes sanguins et le mâle se met à mourir lentement en se dissolvant progressivement, d’abord les organes digestifs, puis le cerveau, les yeux, ne laissant au final qu’une paire de testicules qui libèrent alors le sperme. Bizarre, vous avez dit bizarre ?
les proies se précipitent vers ce phare dans la nuit noire sans voir la bouche du prédateur derrière. Ce poisson est d’ailleurs très spécial et je ne résiste pas à l’envie de vous raconter son mode de reproduction bien particulier. Le mâle est ici beaucoup plus petit que la femelle et il passe son temps à la chercher ; il la repère grâce à son odorat très développé et se colle à elle en la mordant et en libérant de ce fait une enzyme qui dissout sa bouche et la partie mordue de la femelle : les deux animaux fusionnent alors leurs systèmes sanguins et le mâle se met à mourir lentement en se dissolvant progressivement, d’abord les organes digestifs, puis le cerveau, les yeux, ne laissant au final qu’une paire de testicules qui libèrent alors le sperme. Bizarre, vous avez dit bizarre ? dont il fait même son terrier. On peut voir les difficultés que cette petite bête a à transporter sa « boule » le plus souvent bien plus grosse que lui dans l’excellent film « Microcosmos » sorti sur les écrans il y a quelques années. Mais comment fait-il pour se diriger toujours en droite ligne ? Eh bien, il se fie aux étoiles ou plus exactement à
dont il fait même son terrier. On peut voir les difficultés que cette petite bête a à transporter sa « boule » le plus souvent bien plus grosse que lui dans l’excellent film « Microcosmos » sorti sur les écrans il y a quelques années. Mais comment fait-il pour se diriger toujours en droite ligne ? Eh bien, il se fie aux étoiles ou plus exactement à 

 «
«  C’est dire que, rendus à une liberté totale, ils n’ont aucune peine à survivre en solitaires ! Aux USA, il existe plus de
C’est dire que, rendus à une liberté totale, ils n’ont aucune peine à survivre en solitaires ! Aux USA, il existe plus de  terrorisaient les passants. Les autorités locales ont dû prendre de sévères mesures pas toujours comprises des populations locales pour y mettre fin. Le même phénomène s’est produit il y a une vingtaine d’années sur
terrorisaient les passants. Les autorités locales ont dû prendre de sévères mesures pas toujours comprises des populations locales pour y mettre fin. Le même phénomène s’est produit il y a une vingtaine d’années sur  escarpés si bien qu’il est difficile pour un humain de les apercevoir. Ils se sont parfaitement adaptés à leur habitat sauvage au point que l’Homme a réussi à en introduire dans d’autres endroits comme dans les Alpes, la baie de Somme, voire les îles Canaries…
escarpés si bien qu’il est difficile pour un humain de les apercevoir. Ils se sont parfaitement adaptés à leur habitat sauvage au point que l’Homme a réussi à en introduire dans d’autres endroits comme dans les Alpes, la baie de Somme, voire les îles Canaries… peuvent mettre bas que par césarienne, pensons plutôt
peuvent mettre bas que par césarienne, pensons plutôt 
 et les petits mammifères menaçant un peu plus encore la biodiversité (le chat en liberté est considéré comme nuisible en Nouvelle-Zélande). Les autres soutiennent qu’il s’agit comme à chaque fois de partager l’espace avec ces nouvelles espèces qui finiront, un jour ou l’autre, par devenir des
et les petits mammifères menaçant un peu plus encore la biodiversité (le chat en liberté est considéré comme nuisible en Nouvelle-Zélande). Les autres soutiennent qu’il s’agit comme à chaque fois de partager l’espace avec ces nouvelles espèces qui finiront, un jour ou l’autre, par devenir des 

 surprenantes : le
surprenantes : le  d’envoyer quelques éclaireurs pour s’assurer de l’absence de danger lors de la traversée de l’obstacle. Si rien ne se passe, le groupe s’engage dans son intégralité ; sinon, les survivants font marche arrière afin d’aller chercher plus loin un passage plus serein. Aux prix de quelques victimes à chaque fois. Un comportement similaire a été décrit chez des singes comme les
d’envoyer quelques éclaireurs pour s’assurer de l’absence de danger lors de la traversée de l’obstacle. Si rien ne se passe, le groupe s’engage dans son intégralité ; sinon, les survivants font marche arrière afin d’aller chercher plus loin un passage plus serein. Aux prix de quelques victimes à chaque fois. Un comportement similaire a été décrit chez des singes comme les /image%2F1490480%2F20230311%2Fob_b2667b_gratte-ciel-avec-les-nuages-se-refleta.jpg)
/image%2F1490480%2F20230311%2Fob_c87358_tortues-bebes.jpg)
 périlleuses afin d’atteindre les nids d’oiseaux perchés sur des falaises presque inaccessibles. Il ne s’agit pas ici d’un éventuel « comportement d’adaptation » à une situation nouvelle mais d’une simple
périlleuses afin d’atteindre les nids d’oiseaux perchés sur des falaises presque inaccessibles. Il ne s’agit pas ici d’un éventuel « comportement d’adaptation » à une situation nouvelle mais d’une simple 
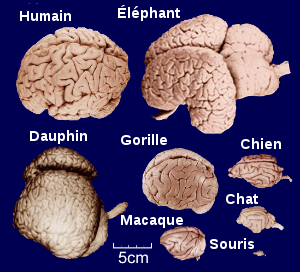 qui est observable et, dans une certaine mesure, quantifiable. Un premier écueil apparaît toutefois : il peut sembler facile de classer les « degrés » d’intelligence en fonction de résultats plus ou moins élevés à des tests mais encore faut-il faire la part de ce qui, dans certains comportements complexes ou parfaitement adaptés, revient à des
qui est observable et, dans une certaine mesure, quantifiable. Un premier écueil apparaît toutefois : il peut sembler facile de classer les « degrés » d’intelligence en fonction de résultats plus ou moins élevés à des tests mais encore faut-il faire la part de ce qui, dans certains comportements complexes ou parfaitement adaptés, revient à des  nouvelle. Par exemple, il a été rapporté le manège d’une
nouvelle. Par exemple, il a été rapporté le manège d’une  de son enclos. Dès qu’elle se fut éloignée de lui, ce dernier alla cacher la clé. Quand la chercheuse redemanda la clé à Kanzi, celui-ci donna l’impression de l’avoir perdue. Accompagné de la scientifique, le singe fit mine de chercher attentivement la clé mais les recherches restèrent vaines. Ce n’est qu’après le départ de la chercheuse que Kanzi alla quérir la clé et s’en servit pour sortir de son enclos. Kenzi était donc
de son enclos. Dès qu’elle se fut éloignée de lui, ce dernier alla cacher la clé. Quand la chercheuse redemanda la clé à Kanzi, celui-ci donna l’impression de l’avoir perdue. Accompagné de la scientifique, le singe fit mine de chercher attentivement la clé mais les recherches restèrent vaines. Ce n’est qu’après le départ de la chercheuse que Kanzi alla quérir la clé et s’en servit pour sortir de son enclos. Kenzi était donc  à un emplacement vide. La construction est faite de telle manière que l’araignée qui voit son butin avant de s’élancer est obligée de le perdre de vue dès qu’elle emprunte les tubes. Le résultat est surprenant puisque l’arachnide se trompe rarement et atteint très souvent sa proie. Les scientifiques en déduisent qu’elle a conservé en mémoire une
à un emplacement vide. La construction est faite de telle manière que l’araignée qui voit son butin avant de s’élancer est obligée de le perdre de vue dès qu’elle emprunte les tubes. Le résultat est surprenant puisque l’arachnide se trompe rarement et atteint très souvent sa proie. Les scientifiques en déduisent qu’elle a conservé en mémoire une  est pourvue d’un abri obscur (abris 1 et 2). On attache un fil électrique à l’une des pattes du crabe de façon à lui adresser une légère décharge électrique lorsqu’il se sera réfugié dans l’un des abris (par exemple, l’abri 1). A compter de la deuxième ou troisième décharge, le crabe choisira systématiquement l’abri 2, preuve qu’il a bien
est pourvue d’un abri obscur (abris 1 et 2). On attache un fil électrique à l’une des pattes du crabe de façon à lui adresser une légère décharge électrique lorsqu’il se sera réfugié dans l’un des abris (par exemple, l’abri 1). A compter de la deuxième ou troisième décharge, le crabe choisira systématiquement l’abri 2, preuve qu’il a bien 
 (
( d’accéder à l’universalité. Puisque, selon lui, les animaux n’ont pas la faculté de posséder une pensée abstraite et donc de réfléchir, il lui semblait évident qu’on pouvait les
d’accéder à l’universalité. Puisque, selon lui, les animaux n’ont pas la faculté de posséder une pensée abstraite et donc de réfléchir, il lui semblait évident qu’on pouvait les  légèrement transformées ou plus ou moins rudimentaires, les
légèrement transformées ou plus ou moins rudimentaires, les  laquelle la plus complète adaptation au milieu terrestre est celle des
laquelle la plus complète adaptation au milieu terrestre est celle des /image%2F1490480%2F20240213%2Fob_d2409a_jupiter-tourbillons-vus-par-juno.jpg)
/image%2F1490480%2F20231207%2Fob_babb88_nebuleuse-du-crayon.jpg)
/image%2F1490480%2F20230904%2Fob_d865b1_enrico-fermi.jpg)
/image%2F1490480%2F20230430%2Fob_25ae20_galaxie-cachee-ic-342.jpg)
/image%2F1490480%2F20230108%2Fob_68c405_voie-lactee-serge-brunier.jpg)
/image%2F1490480%2F20221108%2Fob_ab152c_ngc-55-galaxie-irreguliere.jpg)